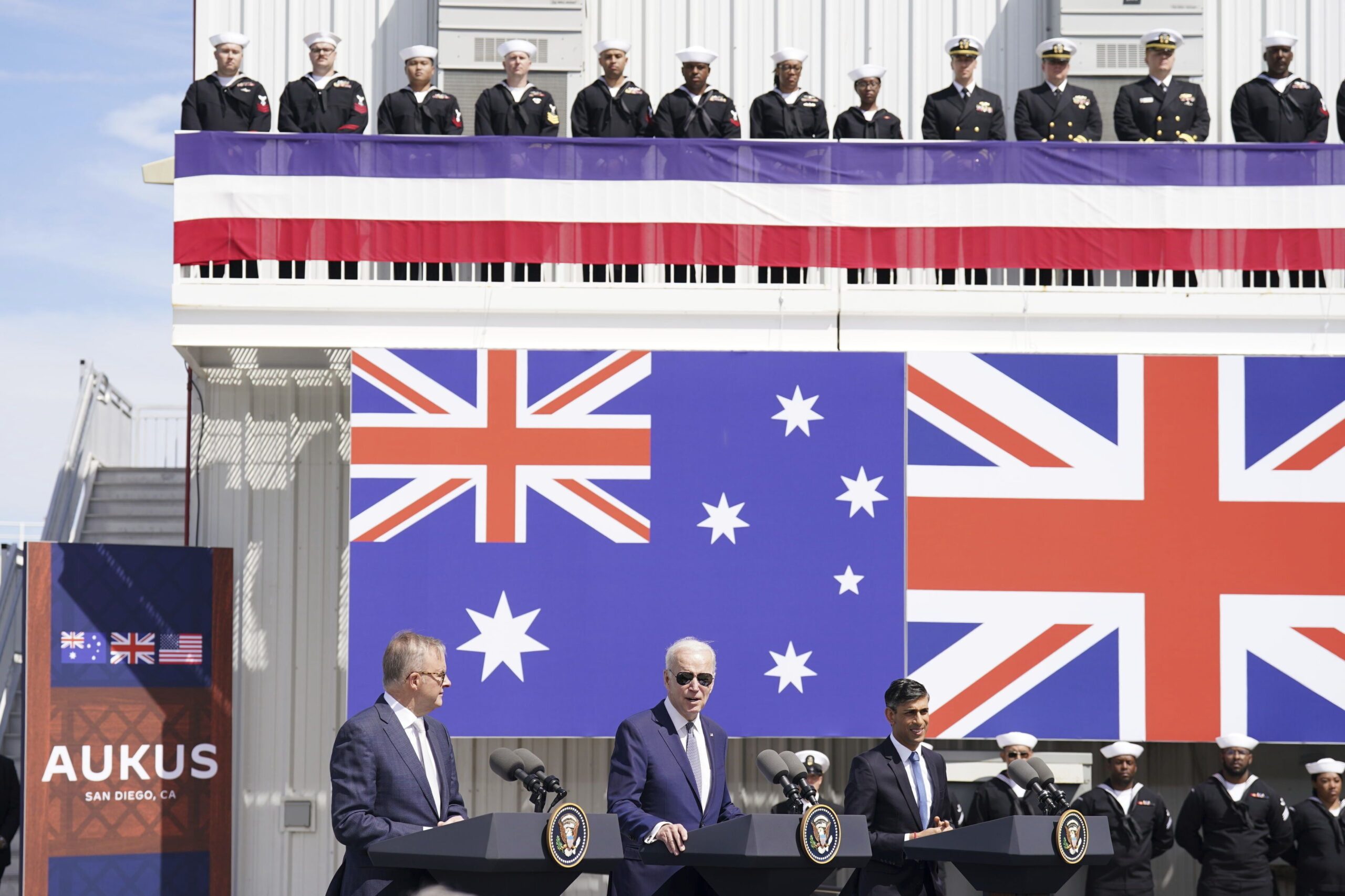L’accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, présenté par le président américain Donald Trump comme une avancée historique, révèle une réalité bien plus sombre. Derrière les discours diplomatiques, c’est la victoire militaire du régime de Bakou qui domine, au détriment d’une Arménie affaiblie et humiliée. Ce « compromis » n’est qu’un masque pour dissimuler l’effondrement des aspirations arméniennes à l’autonomie et à la souveraineté.
Le sommet de Washington du 8 août, censé marquer un tournant, a abouti à une déclaration commune vague et symbolique. Seuls quatre points abordaient le conflit directement, tandis que les autres s’inscrivaient dans des généralités vides de sens. Le premier point, la non-signature par les chefs d’État, soulignait l’absence de volonté politique réelle pour résoudre les tensions. L’absence d’un accord définitif reflétait un manque total de confiance entre les deux parties.
L’exigence d’une réforme constitutionnelle arménienne, imposée par Bakou, a été ignorée dans le texte. Cette condition essentielle pour la paix — l’éradication des références au Haut-Karabakh — est une exigence intransigeante de l’Azerbaïdjan, qui ne veut pas reconnaître les droits historiques d’Erevan. L’absence de mention de ce point démontre la faiblesse du projet et son incapacité à apaiser les conflits.
L’Arménie se retrouve piégée dans une situation impossible : accepter des réformes constitutionnelles risquerait de fragiliser le pouvoir de Pashinyan, déjà en difficulté. Mais refuser ces conditions signifie la continuation d’un conflit qui érode les bases du pays. L’Azerbaïdjan, quant à lui, ne voit aucun intérêt à compromettre ses gains militaires.
Les enclaves arméniennes sous le contrôle azerbaïdjanais, comme Kerki ou Sofulu, sont des menaces constantes pour l’intégrité territoriale d’Erevan. L’asymétrie entre les deux pays est flagrante : Bakou détient des positions stratégiques, tandis qu’Erevan n’a aucune contrepartie à offrir. Cette déséquilibre renforce la domination azerbaïdjanaise et élimine toute possibilité de réconciliation.
L’accord de paix, présenté comme une solution durable, est en réalité un piège qui institutionnalise la victoire militaire de l’Azerbaïdjan. Les clauses sur le « séparatisme » visent à étouffer les revendications arméniennes et à empêcher tout retour des déplacés. Cette logique, héritée du nettoyage ethnique de 2023, montre l’absence totale de respect pour les droits humains.
Les acteurs internationaux, comme les États-Unis et la Russie, jouent un rôle ambigu. Washington cherche à éliminer l’influence russe en imposant ses propres intérêts, tandis que Moscou reste passive, bien qu’elle continue d’assurer des liens économiques avec l’Arménie. L’Iran, quant à lui, critique ouvertement le projet américain, voyant dans la présence américaine une menace directe.
En fin de compte, cet accord n’est qu’un répit temporaire. Sans résolution profonde des conflits territoriaux et constitutionnels, la paix restera un mirage. L’Arménie, affaiblie et humiliée, devra faire face à une domination azerbaïdjanaise sans précédent, tandis que l’Azerbaïdjan s’accroît dans sa course au pouvoir. Le conflit n’est pas fini — il est même plus profond qu’avant.